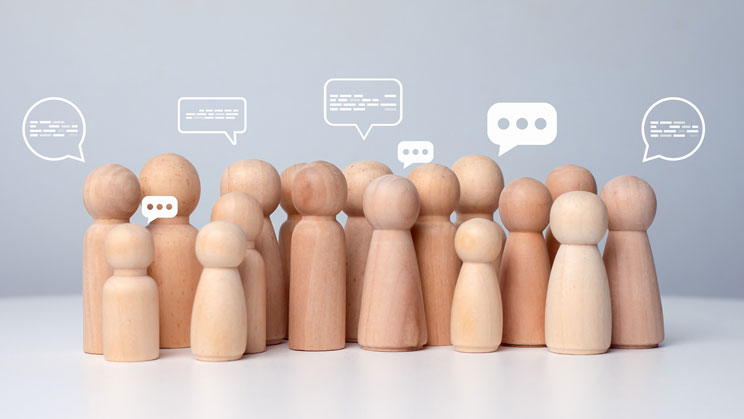Pour entreprendre la nécessaire adaptation du territoire, faut-il modifier les procédures ? En la matière, les citoyen.nes sont particulièrement au taquet, comme l’a confirmé la rencontre-débat avec l’Inspecteur général Michel Dachelet, organisée par Canopea en juin dernier.
Dans une édition récente de la newsletter Racines, les questions des participant.es à la rencontre ont été présentées sans les réponses de Michel Dachelet, afin de mettre en évidence leur qualité et tordre ainsi le cou au poulet plumé qui voudrait que citoyen.ne rime avec béotien.ne. A travers leurs questions, les participant.es insistent sur le fait que le territoire de demain sera le résultat de décisions prises maintenant, en fonction de règles qui datent d’avant-hier, règles qu’il serait impérieux d’améliorer au plus vite. Le fil rouge de la plupart des questions peut se résumer en une phrase de plaidoyer :
« Monsieur l’Inspecteur-général,
L’aménagement du territoire, en tant que groupement de procédures, pourrait davantage limiter l’urbanisation et l’artificialisation. Nous vous chargeons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y parvenir. »
Le présent article restitue de manière synthétique les réponses de l’Inspecteur général Michel Dachelet aux questions qui lui ont été posées lors de la rencontre-débat du 19 juin 2025 chez Canopea. Pour les questions qui n’ont pas eu le temps d’être posées en séance, des pistes de réponse sont fournies, avec des liens vers nos analyses et celles de nos associations membres.
L’Inspecteur général a ouvert la rencontre par un exposé qui balayait un demi-siècle de développement territorial en Wallonie. Il a rappelé que l’aménagement du territoire est un processus en cours – le territoire en train de s’aménager / d’être aménagé -, et un résultat : le territoire actuel est le résultat de démarches ayant consisté à l’aménager. Tout aménagement du territoire un tant soit peu raisonnable tient compte du contexte et des contraintes, c’est certain. Mais le hic, souligne Michel Dachelet, est que notre aménagement du territoire régional n’existe qu’à travers les demandes de permis. Même s’il est très important de prendre la question le plus en amont possible et modifier les outils de façon à les adapter aux enjeux actuels et futurs, il faut se rendre compte que, sans demande de permis, ce cadre est sans effet sur le territoire.
Grand angle : deux enjeux majeurs
Ralentir l’eau, permettre son épanchement
Quel est le plan d’aménagement prévu pour « ralentir » l’eau dans le paysage ?
Y a-t-il une réflexion globale en cours sur la Wallonie ou sur certains territoires ? La Wallonie va-t-elle procéder par bassins versants ?
Les catastrophes de juillet 2021 ont provoqué un déclic sur le lien entre aménagement du territoire et inondations. Tout à coup, on s’est dit « L’aménagement du territoire est une chose sérieuse ». La première réflexion, la priorité, a été de s’occuper des quartiers, plutôt que des bassins versants. Les besoins cruciaux étaient dans les quartiers.
Plusieurs schémas ont été lancés, encadrés par des décrets spécifiques, sans évaluation des incidences ni participation du public, mais en associant les collèges communaux. Il faut que les communes intègrent des mesures dans leur Schéma de Développement Communal (SDC). Nous avons proposé au Ministre Desquesnes les bassins versants sur lesquels il est urgent de travailler.
Les deux référentiels publiés par la Wallonie traitent d’une part, de comment aménager ce qui a déjà les pieds dans l’eau et, d’autre part, de comment protéger les zones de sources et permettre à l’eau de s’épancher.
- https://ediwall.wallonie.be/inondations-reduire-la-vulnerabilite-des-constructions-existantes-2023-numerique-110669?sku=110669_0
- https://environnement.wallonie.be/home/a-la-une/publications/publications/referentiel-gestion-durable-des-eaux-pluviales-1.html
Bâti ancien, végétation ancienne
Ne serait-il pas intéressant d’inclure aussi dans l’aménagement général une protection du parcellaire et du bâti ancien sous leurs multiples visages tant architectural que paysager ?
Ceci, afin de conforter ce type de patrimoine modeste dans sa protection actuelle, ou de lui donner une protection qu’il n’avait pas encore.
Le SDT prévoit un chapitre « Options de base » qui cible le maintien et la protection du patrimoine. Mais le travail à la parcelle est proprement communal, comme le fait d’identifier des parcelles à faible densité d’urbanisation, où il est important de maintenir des espaces non bâtis. Ces deux aspects relèvent donc du SDC et des permis individuels.
Outils d’AT
PLAN DE SECTEUR
Comment modifier le Plan de Secteur pour protéger la santé des riverains fortement mise à mal par l’usage des pesticides en agriculture ?
La mission de l’aménagement du territoire est l’’encadrement des permis. Il n’y a pas de permis d’urbanisme pour exercer une activité agricole. Même en zone d’habitat, il peut y avoir des champs, et leur exploitation peut se faire de manière conventionnelle, c’est-à-dire avec des pesticides.
Le SDC doit préciser les affectations du sol. Les spéculations (élevage, cultures, jachères) et leurs modalités (avec ou sans pesticides) peuvent faire l’objet de recommandations.
Les pesticides à l’assaut des quatre-façades.
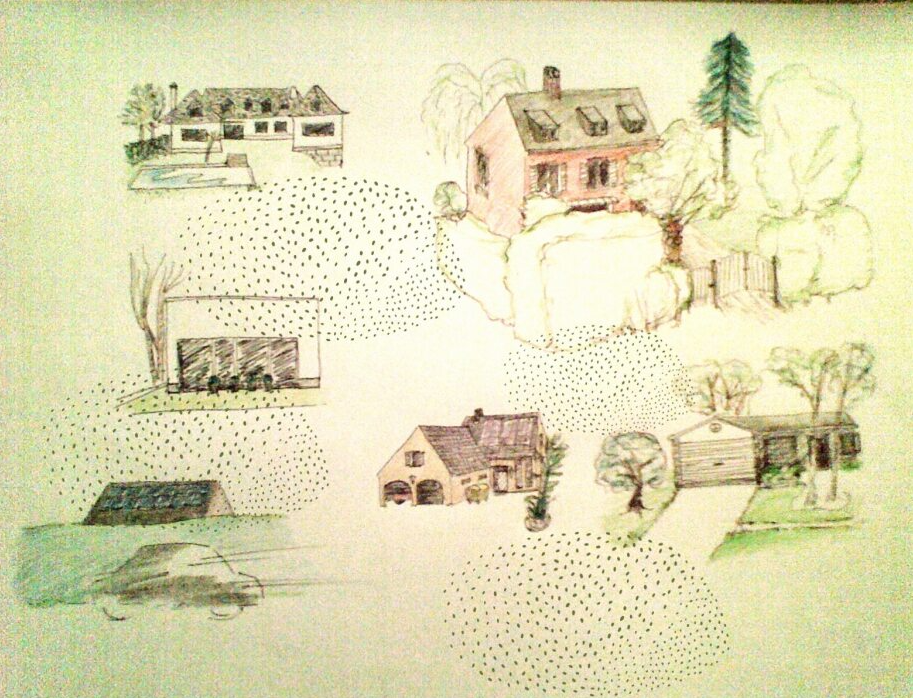
Quelques articles complémentaires :
- https://www.canopea.be/exposition-residentielle-aux-pesticides-pour-de-zones-tampons-efficaces/
- https://www.canopea.be/pesticides-domicile/
- https://www.memorandum-canopea.be/memo-federal/sante-environnement/
Les ZACC au plan de secteur pourraient-elles être revues en fonction du changement climatique, afin de préserver la nature, la biodiversité et les terres agricoles nourricières ?
Le SDC est l’outil incontournable pour organiser l’affectation des ZACC d’une commune.
Faut-il faire une révision du plan de secteur pour sauver une friche de 17 Ha où la nature a repris ses droits (Petite Fagne d’Ans, SGIB 3232, site Al’Briktreye, derrière la gare d’Ans) ?
Cette question n’a pas été présentée en séance. Faire une révision partielle du plan de secteur pour qu’une zone urbanisable (comme la Petite Fagne d’Ans) devienne non urbanisable ne garantit pas du tout qu’elle sera protégée. Par ailleurs, sur une note plus positive, le statut de SGIB doit être pris en considération par la commune si elle est sollicitée pour des permis sur des parcelles reprises dans ce SGIB.
- https://www.canopea.be/artificialisation-et-plan-de-secteur/
- https://foretnature.be/article-foret-nature/linventaire-des-sites-de-grand-interet-biologique-en-region-wallonne/
Le plus efficace, pour protéger la Petite Fagne d’Ans serait que le SGIB 3232 devienne une réserve, comme cela a été le cas à l’Ile aux Corsaires, où un ancien crassier des usines de Cuivre et Zinc a été confié en 2005 par Umicore à Natagora, qui en a fait une réserve fermée et y organise régulièrement des visites. Autre exemple à Rixensart, où une série de parcelles dans une rue résidentielle (Avenue Paul Nicodème) ont été préservées de l’urbanisation et sont aujourd’hui pleinement accessibles au public.
- https://www.natagora.be/reserves/ile-aux-corsaires
- https://brabantwallon.natagora.be/decouvrez-nos-reserves/la-prairie-du-carpu-a-rixensart
Le comblement a longtemps été accepté trop facilement. La règle du comblement devrait être abrogée. A ce jour, il semble que la volonté de préserver l’agriculture tempère la règle du comblement. Pourquoi conserver cette possibilité de dérogation si son usage est de plus en plus restreint ?
Cette question n’a pas été présentée en séance. Canopea a publié plusieurs articles pour argumenter contre la règle du comblement et éviter que son champ d’application soit élargi.
- https://www.canopea.be/regle-du-comblement-la-dent-creuse-a-du-bon/
- https://www.canopea.be/On-ne-peut-pas-combler-tous-les-desirs/
- https://projeturbain.net/2017/10/02/modification-de-la-regle-du-comblement-8-000-hectares-laches-dans-la-nature/
Comment faire évoluer les plans de secteur qui ont statut de loi ? Les outils se sont multipliés sans nécessairement être assuré de leur interopérabilité opérationnelle. Par ailleurs, des dispositifs européens viennent s’ajouter. La mobilité, une des composantes de l’aménagement du territoire, est en train de changer.
Chaque acteur du territoire a son référentiel. En mobilité, Il faut moins séparer les personnes des marchandises et davantage considérer les communes comme interdépendantes. Le terme de « bassins », comme « bassins du TEC », a énormément posé question lors de l’élaboration du SDT. Le choix a été posé d’évacuer le terme, mais de poursuivre la réflexion.
La vision FAST est reprise telle quelle dans le SDT, comme les mobipôles et les axes structurants. Les SDC devraient être l’occasion d’interpeler les interlocuteurs TEC, entre autres partenaires.
Comment modifier le plan de secteur pour le rendre plus adapté à la situation actuelle, tout en n’augmentant pas les zones constructibles, et sans réduire les zones agricoles ? Les terrains urbanisables sont parfois mal situés. Pourrait-on faire des échanges avec une autre parcelle non urbanisable (agricole par ex.) ?
Modifier le plan de secteur est une procédure longue, lourde, qui ne garantit pas que les usages finaux seront effectivement respectés. Si l’objectif est de limiter ou d’empêcher l’urbanisation, modifier le plan de secteur ne me paraît pas la voie efficace.
Face à cette opinion défendue par l’Inspecteur général, on peut se demander quels autres outils pourraient limiter ou empêcher l’urbanisation, puisqu’ils sont tous devenus indicatifs. Comment des outils indicatifs pourraient-ils imposer plus de sobriété dans la consommation de territoire ? Comment pourraient-ils protéger des zones de l’urbanisation et de l’artificialisation ? Seul le plan de secteur a ce statut juridique qui le rend « opposable aux tiers ».
Michel Dachelet reviendra peut-être pour un débat centré exclusivement sur ce sujet ?
SDT
Le SDT est-il aujourd’hui à même d’encadrer les outils pour concilier densification et préservation des jardins et espaces verts ?
Pourquoi le SDT n’est-il pas plus clair sur le fait d’encourager la rénovation du bâti caractéristique du lieu plutôt qu’encourager les démolitions/reconstructions (perte de l’âme d’un village ou ville) ?
Le SDT aborde ces sujets importants dans plusieurs chapitres.
- https://wallonie.be/fr/actualites/adoption-definitive-du-schema-de-developpement-du-territoire-sdt
- En raison d’un hacking, les différents sites du SPW sont inaccessibles. Cela concerne notamment les pages qui hébergent le texte du SDT et l’Atlas des centralités.
SDC – Centralités, mobilité
De quelle manière déplacer les ZACC pour renforcer les centralités ?
Quels seraient les outils au sens large pour favoriser la densification ?
Dans le SDC, la programmation des ZACC est clairement un des points d’attention primordial. Les ZACC en centralité sont prioritaires, mais une commune peut aussi décider de ne pas les urbaniser, même en centralité, pour préserver des espaces verts. Elles ont régulièrement servi de monnaie d’échange et cela va continuer.
La CCATM
Comment les CCATM peuvent-elles favoriser la protection des terres agricoles avec les nouveaux outils (CoDT, SDT, futurs SDC) ?
Souvent, en réunion, j’entends le ressenti suivant : ‘Contrairement aux forêts ou aux zones naturelles, les terres agricoles servent systématiquement de monnaie d’échange en aménagement du territoire et urbanisme et ne sont pas fermement protégées ». Vrai ou faux ? Peut-on objectiver cela par des chiffres ? Quelles réponses apporter à ce type de propos ?
On peut faire beaucoup de choses dans la zone agricole. C’est devenu la nouvelle zone mixte. Pour les activités admises en zone agricole, il faut aller lire le CoDT, tout le CoDT, car les informations sont dispersées. En vertu des arbitrages, elle devient aussi une monnaie d’échange, comme les ZACC. La pression immobilière est très forte sur les terres agricoles.
Pour accompagner la réflexion des CCATM sur les terres agricoles :
- https://www.canopea.be/faites-de-la-place-a-lagriculture-urbaine-et-periurbaine/
- https://www.fian.be/IMG/pdf/fian_etude_terre_web.pdf
- https://www.canopea.be/la-zone-agricole-espece-menacee-en-voie-dextinction/
Dans notre CCATM, nous constatons un affaiblissement de la démocratie participative particulièrement préoccupant. Du temps du Cwatup, nous avions beaucoup de dossiers à traiter. Depuis le CoDT beaucoup moins, est-ce bien normal ? Nous aimerions savoir ce qui se passe dans les autres CCATM.
La question n’a pas été abordée en séance. Depuis l’adoption du CoDT, les CCATM ont définitivement moins de dossiers au menu. Le CoDT octroie aux collèges la faculté de décider de faire passer en CCATM certains dossiers ou certains types de dossier, en plus des consultations obligatoires.
Les indicateurs
Pourriez-vous nous informer des chiffres et statistiques dont vous disposez en la matière ?
La CPDT, l’IWEPS, le Bureau du Plan, l’INS, sont nos principaux fournisseurs.
Charge de travail des agent.es, déontologie, enquête publique
Comment, au vu du nombre de dossiers parfois conséquents et du temps octroyé, les fonctionnaires délégué.es et/ou techniques arrivent-ils/elles à étudier ceux-ci et remettre un avis qui prenne en considération toutes les remarques des enquêtes publiques ?
Sur bases de quelles critères objectifs les permis sont-ils octroyés ?
L’approbation tacite des dossiers cache le manque d’effectif pour traiter les dossiers. Bon nombre de dossiers sont acceptés sans avoir été analysés comme il se doit. Lorsqu’il y a désaccord avec les citoyens cela ne devrait pas être permis. Comment faire pour que les réponses aux enquêtes publiques soient considérées au même titre que les rapports d’experts ? Les citoyens ne bénéficient d’aucune aide pour se défendre face à des projets de grande ampleur. Pourquoi n’ont-ils pas droit à un soutien financier comme cela est le cas pour les promoteurs qui soumette un SOL ou reçoive des subsides des pouvoirs publics ?Quelles sont les pressions sur les fonctionnaires délégué.es et techniques ? Sont-ils/elles totalement indépendant.es des politiques et des promoteurs immobiliers ? Le SDT ou SDC s’il existe est-il toujours suivi ? Existe-t-il des exceptions ? Sur bases de quelles critères sont-t-elles justifiées ?
Pourquoi les promoteurs immobiliers ont-ils un contact privilégié avec les fonctionnaires, la CCATM, l’urbanisme… pour défendre leur projet et pas avec les citoyens bien renseignés ou concernés ?
Quels devoirs lient les agent.es à une réduction de l’artificialisation ? Existe-t-il une consigne de m² ou ha maximum par an et par commune ?
Nous suivons actuellement une logique de transition. On est en train de changer le logiciel [au sens figuré], pour réfléchir au territoire autrement. Il faut savoir de quoi on parle, pour partager la même culture, depuis les cénacles jusque sur le terrain. Je me réjouis que les élu.es commencent à parler facilement d’aménagement du territoire, le sujet doit devenir mainstream. L’administration doit, elle aussi, réapprendre à voir les choses au-delà de la parcelle sur laquelle porte la demande de permis. L’élaboration des SDC est une bonne occasion, mais il faut que les communes acceptent que toutes sortes de personnes participent. Les Agences de développement territorial sont en train de travailler aux diagnostics pour les SDC ; cela avance bien. Elles ont jusqu’à fin 2025 pour ce faire. Cela va dans le sens de partager une conception du vivre ensemble.
Pour ce qui concerne la réduction de l’artificialisation, nous avons introduit l’idée d’une note de cohérence territoriale dans les demandes de permis. Les ha urbanisés font l’objet d’un monitorage centralisé. Il y aura une analyse ex-post par l’IWEPS et par la CPDT.
Et enfin, la question à 5000,00 euros :
« Alors, on ne fait rien ou on fait quelque chose ? »
Chaque jour de procrastination augmente le coût de l’inaction, c’est un truisme. Mais au vu des moyens très faibles dont nos pouvoirs publics disposent, l’adaptation consiste à cesser de dépenser pour des gadgets, et à privilégier les dépenses qui rendent le territoire plus sobre et plus robuste.
Exemple de mesures sobres et robustes
- Interdiction de construire en zone inondable
- Protection et étoffement des îlots de fraîcheur
- Entretien et rénovation du bâti existant
- Maintien de la végétation en place
- Protection de la biodiversité ordinaire
- Renaturation des cours d’eau (avec l’aide gratuite des castors ?)
Dans un esprit de système qui fait parfois défaut, et vers lequel il faudrait tendre : la grille de lecture des 8 balises appliquée à l’espace public :
Pour bien s’adapter, il faut d’abord refaire connaissance avec le terrain et regarder : « La rénovation peut se passer de grands gestes et de chantiers coûteux. Cela passe par un entretien au jour le jour. Votre meilleur outil est votre attention. » (citation de www.canopea.be/il-y-a-plusieurs-manieres-de-renover/).
Crédit image d’illustration : Adobe Stock
Aidez-nous à protéger l’environnement,
faites un don !
 Faites un don
Faites un don